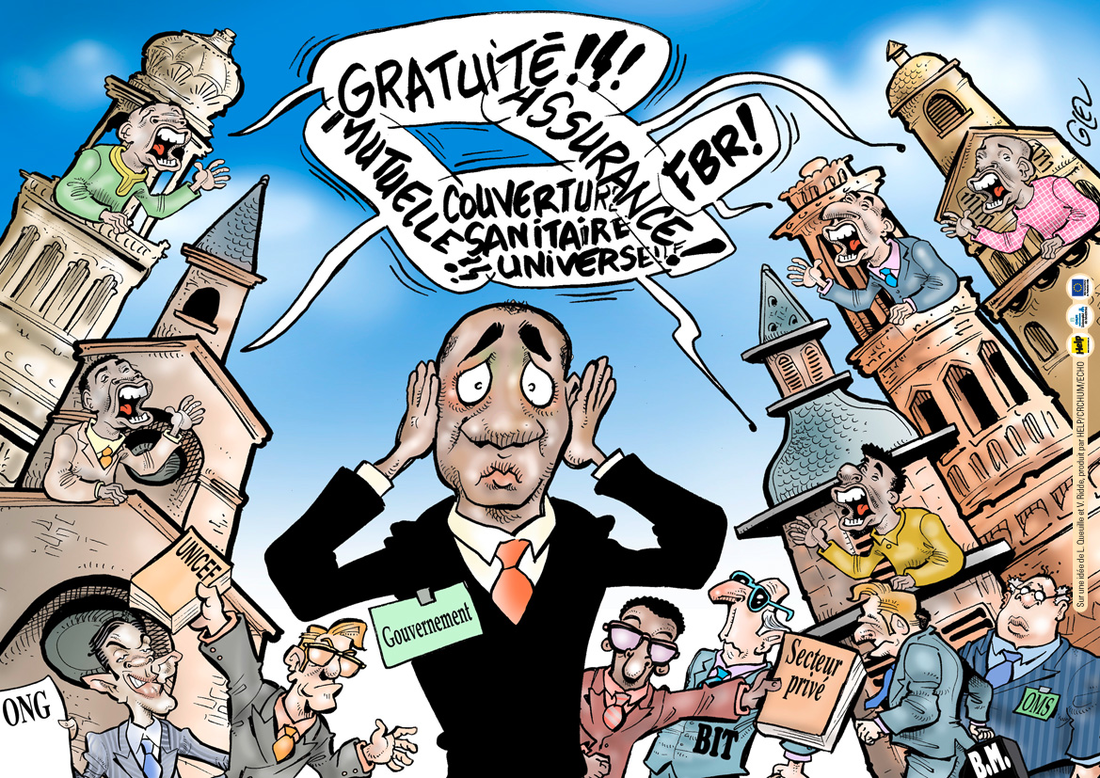Un outil standard dans un programme de financement basé sur la performance (FBP) est le plan de management (ou business plan). Mes visites sur le terrain m'ont amené à m'interroger sur l'efficacité de cet outil. Fin janvier, j'ai lancé une consultation sur le forum en ligne de la CoP FBP et celui du hub RDC. Vous avez été nombreux à rendre un avis et partager une expérience. Dans ce billet de blog, je reviens avec une synthèse de notre discussion.
Malheureusement, cet outil en lui-même ne peut pas faire une transformation magique des structures de santé, il reste actionné par l’humain. Si cet acteur essentiel qu’est l’humain ne fait pas attention, l’outil devient inefficace, un document de simple routine pour faire plaisir à l’administration et aux gestionnaires des projets qui le réclament pour meubler leur classeurs. Comment éviter que le plan de management ne devienne une pièce et une procédure de plus à la bureaucratie sanitaire, quelque chose qui embête le gestionnaire de la formation sanitaire plutôt que l’aider ? Comment éviter que le FBP reproduise les lourdeurs qu’il a lui-même dénoncé ailleurs? Voilà un peu le contenu de la discussion que j’ai lancée sur deux forums (celui de la CoP FBP et celui du HUB RDC), il y a quelques semaines. Une quarantaine d’experts ont donné leur avis sur cet outil en montrant des réalités contextuelles très variées. La synthèse de ces riches réflexions s’articule en 6 points: l’outil lui-même, son élaboration, son cycle, sa mise en œuvre, son suivi et son évaluation, son coaching. Cette structure résume et met en lumière les grandes idées qui sont apparues dans les différents commentaires.
1 - L’outil lui-même
Les premières expériences en FBP ont permis de développer l’outil du plan de management. Celui-ci a ensuite été copié/utilisé dans plusieurs pays. Peut-être n’avons-nous pas toujours bien apprécié si l’outil était transférable tel quel dans des projets de taille parfois très différente, dans des contextes très diversifiés. L’outil rassemble des statistiques, de l’information sur les ressources disponibles et sollicite une analyse des problèmes par domaine et la mise en avant de solutions. L’outil est long (une quinzaine de pages au moins). Les intervenants à notre discussion considèrent que le document est en fait trop long et trop lourd et qu'il mérite d’être revu. Il est aussi coûteux : dans des contextes difficiles, avoir autant de copies pour la structure, l’Agence de Contrôle & Vérification, l’équipe de district etc. devient difficile. Dans la mesure où l’on veut que cet outil soit efficace, il doit être le plus simple et concis possible. D’autant plus que le plan de management ne vient pas remplacer le plan annuel de la structure. L’outil doit être contextualisés et adapté aux réalités de chaque pays et de chaque région pour ne pas perdre sa crédibilité. Trop de couper/coller a eu lieu.
2 - Son élaboration
Son élaboration par la formation sanitaire ne doit pas être laborieuse : l’équipe doit pouvoir décliner en quelques lignes ce qu’ils vont faire au niveau de la formation sanitaire pour résoudre leurs problèmes. Cette qualité est cruciale car elle affecte directement sa mise en œuvre. À titre d’exemple, dans certaines situations, on pense que les agences de contractualisation et de vérification se substituent aux formations sanitaires pour élaborer ces plans de management (au nom du coaching). Les structures sont juste invitées à prendre connaissance de « leur » plan de management et à le signer ! L’élaboration devient tellement lourde que, dans un contexte de personnel insuffisant, le plan de management est élaboré par le seul responsable de la structure sans impliquer ni son équipe ni la communauté. Parfois, pour gagner du temps, les prestataires font du copier-coller avec le plan passé afin de répondre à l’exigence du temps et des délais. Il en sort alors des plans de management très théoriques qui ne seront en réalité pas utilisés par les prestataires. On constate que ce temps d’élaboration et de validation devient tellement long que finalement, à sa finition, il ne reste plus suffisamment de temps pour le mettre en œuvre. Les experts ayant participé aux discussions pensent que la lourdeur de l’outil ralentit le processus d’élaboration. Selon eux, il n’est pas nécessaire de mettre toutes les informations dans le plan de management qui doit être vu comme un référentiel de gestion de la structure pratique. Dès lors, certains experts proposent un document de maximum 5 pages. Il est très important d’insister sur une élaboration participative de toutes les équipes et surtout de laisser les prestataires faire cette planification en leur accordant suffisamment de temps pour leurs autres activités. Certes, au début les plans de management seront de mauvaise qualité, mais, il faut le laisser s’améliorer progressivement – c’est aussi une démarche d’apprentissage pour l’équipe. Méfiance donc : si au début d’un projet avec FBP, les plans de management sont très beaux, cela peut indiquer qu’il n’a pas été préparé par l’équipe du centre de santé. Les vérificateurs des ACV ou les équipes cadre des districts (ECD) ont fait le boulot eux-mêmes!
Le temps d’élaboration du plan de management doit être court, et sa validation doit se faire sur des points clés et ciblés (ambition de la quantité, ambition de la qualité, budgets) afin de réserver suffisamment de temps à la mise en œuvre. L’élaboration du plan de management doit exploiter les données récentes concernant la quantité et la qualité des soins pour planifier les prochains objectifs. Or, dans de nombreux cas, ces données ne sont pas au rendez-vous car les ACV ou les ECD tardent à les fournir et, par conséquent le plan se base sur des données périmées, voire sur une absence de données. Cette situation renforce l’illusion des plans de management. Il est important que la performance des ECD et des ACV soit évaluée en tenant compte de ces évaluations; celles-ci doivent permettre aux structures de disposer de données probantes en temps réel pour pouvoir planifier sur le réel.
3 - Son cycle
C’était en fait ma question de départ sur les forums : à quelle fréquence le plan devrait-il être produit ? Tous les 3, 4 ou 6 mois ? Sur cette question, toutes les possibilités ont été envisagées. De nos discussions, il émerge qu’un certain nombre d’éléments importants sont à prendre en compte. Un principe de base : quelle que soit la durée du cycle, il est important d’assurer le suivi et le financement du plan de management. A nouveau, trop souvent la pratique diverge la théorie : les plans sont élaborés mais très peu suivis. Qu’il s’agisse de 3, 4 ou 6 mois, il faut tout simplement fixer les cycles de suivi afin de s’assurer de l’efficacité de l’ensemble du processus. On peut faire un plan de 3 mois et faire le suivi chaque mois, faire un plan de 4 mois, faire le suivi tous les 2 mois ou un plan de 6 mois, faire le suivi tous les 3 mois… Là aussi, le contexte, les capacités techniques et logistiques des équipes de district et des ACV, la taille du projet devront déterminer le cycle de suivi, quelle que soit la durée du plan. Dans tous les cas de figure le cycle se voit souvent amputé dans une large proportion lorsque l’on prend le temps que cela exige pour l’élaboration, la validation, le paiement etc. Par exemple, sur un cycle de 3 mois, jusqu’à la moitié du temps est consacrée à la planification, ne laissant que l’autre moitié à la mise en œuvre. Cette situation est à la base de la reconduction des plans et l’on va ainsi de report en report. Ainsi, en fixant le cycle d’élaboration d’un plan de management, il est important d’établir une ligne de temps et surtout de fixer un cycle qui laisse aux prestataires le temps de réaliser la mise en œuvre avant le prochain plan.)
4 - Sa mise en œuvre
Nous sommes tous conscients que la mise en œuvre du plan de management pose des sérieux problèmes dans nos contextes actuels. Plusieurs experts partagent cette conviction. Le plan de management est devenu très théorique et le vrai management des structures de santé ne repose pas sur ce document. Lourd, réalisé en retard et, dans certains cas, fait par les ACV ou les ECD, le plan de management tourne en rond et se répète comme un rite ! Personnellement, je constate comme d’autres experts, que cette mise en œuvre patine, principalement à cause des retards de paiement de subsides qui sapent le FBP dans plusieurs pays. Même si le plan de management peut être alimenté par d’autres sources financements, les subventions apportées constituent souvent l’essentiel. Un retard de paiement a donc forcément un impact négatif sur la production. Sans paiement régulier, la mise en œuvre d’un plan se résume généralement à des activités sommaires. Il faut assurer que les ressources arrivent avant la mise en œuvre et non après celle-ci, de sorte que le plan de management reflète des changements pratiques et permettre une vraie transformation. Trois éléments supportent la mise en œuvre: le temps qui lui est consacré, l’arrivée prompte des subventions dans la structure et l’appropriation du plan par les acteurs eux-mêmes — appropriation qui sera largement influencée par sa simplicité. Sur ce point, il est fortement déconseillé de voir le plan de management uniquement comme un outil de gestion des subsides : il doit inclure d’autres ressources comme les recettes du recouvrement des coûts, les autres subventions, les salaires versés par le gouvernement. Il doit être multi-source et devenir un document d’alignement.
5 - Son suivi et son évaluation
Quel que soit le cycle du plan de management, le suivi reste indispensable pour s’assurer que les actions prévues sont effectivement menées. Il ne faite pas confondre le cycle de planification et le suivi du plan de management. Même si celui-ci est de 6 mois, il est tout à faire possible d’effectuer un suivi et un recadrage mensuels. Dans cette optique, il faut éviter de soumettre les prestataires à des cycles théoriques de planification. Quoi qu’il en soit, le bon sens doit primer et, dans la mesure du possible, les acteurs doivent disposer d’un maximum de temps à consacrer à la mise en œuvre et au suivi. Il faut également prévoir du temps pour le suivi car, dans la majorité des cas, on note que le temps consacré au suivi du plan de management est insuffisant. Pire encore : dans certaines structures le plan de management est inexistant. Les missions de coaching, les rencontres mensuelles doivent être des fenêtres d’opportunité.
6 - Le coaching
Le coaching des structures de santé est indispensable pour que le plan de management réussisse. Malheureusement, comme rapporté plus haut, au nom du coaching, certains se substituent au rôle des formations sanitaires. De plus, le coaching n’est bien souvent pas structuré: tantôt pris en charge par des vérificateurs (qui, bien souvent, n’ont pas le temps de bien faire) tantôt par les ECD… et, entre les deux, une mauvaise communication. Il est important de bien identifier les points de coaching dans le plan de management et non en dehors. On ne peut pas coacher toutes les structures de la même manière ni et sur les mêmes thématiques. Les missions de coaching non nécessaires et mal préparées coûtent cher au FBP. Il faut donc une bonne analyse qui permettra de cibler les points à améliorer. Plus loin, le lien entre le coaching des vérificateurs et les ECD doit être bien clarifié en terme de domaines et, surtout, de responsabilités respectives. Dans tout les cas, le contexte doit bien définir les responsabilités et les moyens de mesurer l’efficacité de ce coaching.
Le plan de management est une belle idée. Cela marche par endroit, mais certainement pas partout. Voici nos principales recommandations: il doit être adapté au contexte de chaque pays, de chaque région etc. Il doit être très simple et peu volumineux afin de faciliter son élaboration dans le temps. L’élaboration d’un plan doit prendre un minimum de temps afin de pouvoir en consacrer suffisamment à la mise en œuvre. Car celle-ci a besoin de ressources — essentiellement les subsides, dont le paiement doit par conséquent être régulier et prompt. Un plan de management doit être suivi par le propriétaire en premier lieu et les autres acteurs ensuite, être un outil au service de la structure de santé et non des ACV qui, avec les ECD doivent unir leurs forces pour apporter un coaching ciblé afin de solutionner les problèmes que la structure met en exergue.