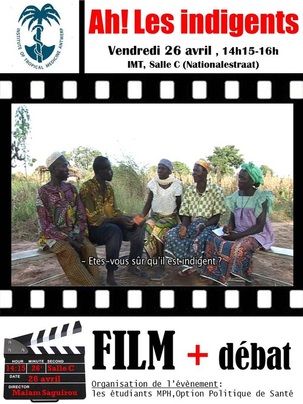Juliette, quels étaient les objectifs de cette recherche?
La façon dont le système de santé est financé a une incidence sur l'accès aux services de santé de qualité et sur la protection des ménages contre les difficultés financières. Le financement de la santé joue un rôle central dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et de la couverture maladie universelle (CMU). Nous notons que plusieurs pays de la Région africaine de l'OMS sont en retard dans la réalisation des OMD; nous avons entrepris cette recherche pour comprendre les changements dans le financement de la santé qui se sont produits dans les pays, en tenant compte des principales sources de financement sur une période de 10 ans (2000 à 2009). Plusieurs pays de la région sont concernés par le faible niveau de financement et le niveau élevé des paiements directs par les usagers, plusieurs sont en cours d’élaboration des stratégies de financement de la santé tandis que d'autres sont en discussion / conception / mise en œuvre des réformes du financement de la santé. Cette analyse des tendances peut orienter le débat sur des stratégies appropriées de financement de la santé, mais aussi peut guider la conception des réformes du financement de la santé.
Quelles sont vos principales conclusions?
Nous avons noté divers niveaux de dépenses de santé, avec certains pays ayant augmenté les investissements tandis que d'autres les réduisaient au cours de la période de 10 ans. Le nombre de pays ayant atteint les recommandations de la Commission Macroéconomie et Santé de dépenser au moins 34 $ américains par personne et par an a augmenté de 11 à 29 tandis que le nombre de pays qui ont atteint les recommandations du Groupe de travail international sur financements innovants de dépenser au moins 44$ américains par personne par an a augmenté de 11 à 24.
Les investissements des gouvernements en matière de santé ont augmenté dans la majorité des pays au cours de la période de 10 ans comme en témoignent les dépenses publiques de santé en pourcentage des dépenses totales de santé qui ont augmenté dans 31 pays (sur 45 pays). Nous avons cependant noté une diminution de ces investissements dans 13 pays. Le poids des sources privées en pourcentage des dépenses totales de santé a baissé, comme le confirme la réduction du nombre de pays où les dépenses privées représentent 50% ou plus des dépenses totales de santé : on est passé de 29 (soit 64% des pays) à 23 (51%). Mais les frais à la charge des patients restent élevés et la majorité des pays sont loin d'assurer la protection contre le risque financier. L’augmentation du prépaiement par l'assurance a été maigre. Les pays finançant partiellement la santé à travers la sécurité sociale ont augmenté de 19 à 21 et le nombre de pays ayant des régimes privés de prépaiement est passé de 29 à 31.
Les résultats de votre recherche ont révélé des différences significatives entre les pays en termes de dépenses publiques de santé en pourcentage des dépenses totales de l'État, et en termes de changements au cours des 10 ans. Selon vous, quels sont les principaux facteurs qui ont poussé certains gouvernements à accroître leur financement et d'autres à le diminuer?
Le financement du gouvernement joue un rôle clé dans le financement des services de santé étant donné qu'il est souple et plus prévisible que, par exemple, le financement des bailleurs de fonds. C’est une preuve de l'engagement du gouvernement d’investir dans le développement de la santé de ses citoyens. Dans cette recherche, nous avons en effet constaté des variations importantes avec certains pays augmentant leur contribution à la santé en pourcentage du total des dépenses publiques tandis que d'autres la réduisaient au cours de la période de 10 ans.
Plusieurs facteurs ont fait que certains gouvernements accroissent leur financement, mais dans l’article, nous en avons exploré quelques uns.
L'engagement pris par les chefs d'Etat à Abuja en 2001 pourrait expliquer en partie l'augmentation de l’effort public dans certains pays. Cet engagement a été réitéré à plusieurs réunions de l'Union Africaine, lors de conférences des ministres de la Santé et des ministres des finances, des séances du comité régional pour l'Afrique de l'OMS, et plusieurs panels de haut niveau de financement de la santé (Kampala, Juillet 2010, l'Ethiopie, Mars 2011, Yamoussoukro, Septembre 2012). Ceux-ci auraient pu servir de rappels constants aux gouvernements d'accroître les investissements dans la santé. Nous avons cependant besoin de prêter attention aux critiques sur l’engagement d'Abuja qui ont été soulevées à plusieurs reprises en ce qui concerne la pertinence du pourcentage fixé. Certains ont soulevé le fait que même si cela est respecté, l'investissement par habitant dans la santé sera toujours faible, tandis que d'autres ont déclaré que ces engagements ne sont pas réalisables dans le cadre du budget global d'un pays. Le ministre des finances de la Sierra Leone, dans l'une des tables rondes, a présenté un scénario où les engagements du gouvernement en termes de pourcentage d'attribution aux différents secteurs dépassaient 100%. Cela pourrait expliquer la stagnation, voire la diminution de certains pays.
Pour certains pays qui ont enregistré une augmentation significative de la dépense publique dans leurs «dépenses totales de santé», l’explication pourrait résider dans une vision renouvelée sur la santé, et ce de plusieurs façons. Ici, nous notons par exemple le Ghana, l'Éthiopie, l'Ouganda et le Rwanda. Ce sont des pays qui ont adopté des approches sectorielles (SWAp), dans le cadre desquelles une vision claire a pu être articulée, le soutien des bailleurs de fonds harmonisé et aligné sur les plans sectoriels, les mécanismes de mise en oeuvre simplifiés et acceptés par les gouvernements et les partenaires, et le suivi de la performance du secteur renforcé et rendu plus inclusif. Des instruments pour guider la mise en œuvre des programmes de santé dans les approches sectorielles ont été élaborés (protocole d’entente par exemple) avec engagements de tous les partenaires. Les succès de cette approche ont été documentés par exemple en Ouganda par Ortendahl. Cela aurait aidé à améliorer l’image du secteur (comme mieux organisé avec une stratégie claire) et augmenter l'investissement du gouvernement, mais aussi adopté comme une fin en soi, dans le but de respecter les engagements respectifs repris dans les documents directeurs.
Certains pays qui ont enregistré une baisse des dépenses de santé en pourcentage des dépenses publiques totales ont enregistré une hausse de la contribution des sources externes. En guise d’exemple, la Sierra Leone, l’Érythrée, le Kenya, la Namibie et le Swaziland sont des pays de cette catégorie. Qu’il y ait eu un phénomène de remplacement (‘crowding-out’), où l'augmentation des sources externes suscite la réduction des investissements de ressources de l'État, ne peut pas être confirmé avec les éléments de preuve disponibles, mais c’est un facteur explicatif possible.
L'avenir des ressources domestiques comme une source importante de financement dépendra de : 1) la capacité des pays à produire des recettes locales 2) renforcement des systèmes administratifs de recouvrement de l'impôt et 3) la volonté politique d'investir dans la santé.
Lagarde et Palmer que vous avez citées dans votre article mentionnent qu’une augmentation de l’utilisation services de santé est possible lorsque les paiements directs augmentent si il y a une amélioration simultanée de la qualité. Cet argument reste-il valide pour maintenir les paiements direct par les usagers, avec comme objectif d'éviter le manque de ressources dans la prestation des services de santé?
Les paiements directs des usagers élevés pour la santé restent un sujet de préoccupation étant donné les conséquences négatives, qui ont été depuis longtemps un sujet de débat. Certaines personnes ont fait valoir que si la qualité des soins va être améliorée alors peut-être les paiements directs d'utilisation ne sont pas aussi mauvais qu’on ne l’a dit.
À notre avis, le maintien des paiements directs en raison de possibles améliorations de la qualité peut ne pas être une bonne option pour plusieurs raisons. Lorsqu’on regarde les données disponibles sur les situations, où la qualité a été améliorée aux côtés des paiements directs, on note que celles-ci relevaient d’environnement pilote ou de recherche-action. Ces expérimentations sont caractérisées par une surveillance et un suivi rigoureux qui pourraient être coûteux à mettre en œuvre au niveau national. En ce qui concerne le comblement de l'écart en matière de ressources, il a été démontré que dans la majorité des situations, la contribution des paiements directs était limitée. Compte tenu des paiements directs élevés pour la santé dans la majorité des pays de la région africaine, explorer comment ces paiements directs pourraient passer par des mécanismes de prépaiement est l'une des options. Une autre question qui n'a pas reçu une attention suffisante dans le débat sur la réduction des frais à la charge des patients est le rôle du secteur privé. Un pourcentage important de la population, les pauvres inclus, se fait soigner dans le secteur privé où les coûts sont élevés et la qualité des soins n'est pas garantie. Résoudre la question des frais à la charge des patients dans le secteur public seul ne suffit pas pour réduire les frais à la charge des patients. Il y a nécessité de mécanismes de régulation du secteur privé, de contrôler la hausse des coûts et d'assurer la qualité des soins, et d'octroyer des subventions au secteur privé pour lui permettre de réduire ses coûts.
En 2006, la cinquante-sixième session du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique a adopté une résolution sur le financement de la santé qui invite les Etats membres à renforcer rapidement les systèmes nationaux prépaiement de financement de la santé. Comment ces systèmes avec prépaiement ont-ils évolué depuis la résolution?
Depuis la résolution, mais même avant cela, plusieurs pays se sont impliqués dans la discussion et la conception de systèmes d'assurance-maladie. Depuis 2000, l'Ouganda a discuté la faisabilité de l'introduction de l'assurance-maladie, ce qui a abouti à une étude de faisabilité de l’assurance maladie sociale en 2008. Le Kenya a exploré l'expansion de la caisse de l'assurance-hospitalisation nationale afin de couvrir non seulement l'employé du secteur formel, mais aussi ceux qui travaillent dans le secteur informel. Le Burkina Faso, le Lesotho, le Swaziland et Zanzibar (Tanzanie) ont entrepris des études de faisabilité. Le Rwanda a entrepris une révision détaillée de son financement de la santé pour guider une nouvelle expansion de son assurance maladie à base communautaire. La Sierra Leone est au stade de la conception de l’assurance sociale santé. Mettre en place des mécanismes de prépaiement est l'un des plus grands défis auxquels sont confrontés les pays dans les régions AFRO. Un grand nombre de discussions et d'études sont en cours, mais les progrès réels sont encore à réaliser.
Le retard dans la phase de conception, d'une part est compréhensible compte tenu du fait que plusieurs des conditions favorables à la mise en place des régimes d'assurance-maladie ne sont pas en place. Par exemple, le secteur formel constitue seulement un petit pourcentage de la population, la population est essentiellement rurale ce qui pose des problèmes administratifs, les revenus sont faibles et le secteur informel n'est pas très organisé dans plusieurs pays. En outre, le fait que près de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté international dans la Région africaine pose un défi de la capacité de payer des primes d’une assurance sociale santé.
Les défis à surmonter pour commencer l'assurance maladie sont multiples, parmi lesquels on peut certainement citer la faiblessse des systèmes de santé qui sont censés offrir les soins couverts par l’assurance. Il faudra pour cela des subventions spécifiques pour améliorer et accroître la capacité du système à fournir les services couverts. La capacité administrative pour concevoir et gérer les régimes d'assurance fait aussi défaut dans plusieurs pays. Le dialogue dans les pays pour parvenir à un consensus n'a pas été facile et le processus a été un long débat de va-et-vient. A titre d’exemple, des discussions sont en cours en Ouganda depuis 2000, mais ce n’est qu’en 2010 qu’un accord sur le design a été trouvé ! Au Kenya, le processus a aussi pris du temps, a finalement progressé, mais pour être bloqué, au stade de la signature du décret de l’assurance-maladie, par les syndicats, des assurances-maladie privées, des hôpitaux privés et d'autres teneurs d’enjeux ayant des intérêts contraires. La compréhension du concept d'assurance-maladie et l’appréciation de l’importance de la solidarité sont encore très faibles dans nos sociétés ; cela appelle à la sensibilisation, même auprès des élites.
Nous avons cependant des récits de réussites d'assurance maladie, par exemple, le Ghana et le Rwanda. La décision de commencer ou ne pas commencer un régime d'assurance-maladie est une décision du pays, mais une attention particulière doit être portée aux détails dans les phases de conception, de développement et de mise en œuvre. Il est extrêmement important de développer des mécanismes permettant de diagnostiquer les goulots d'étranglement et d’avoir un plan de mise en œuvre pour les résoudre en temps utile pour construire/maintenir la confiance de tous.