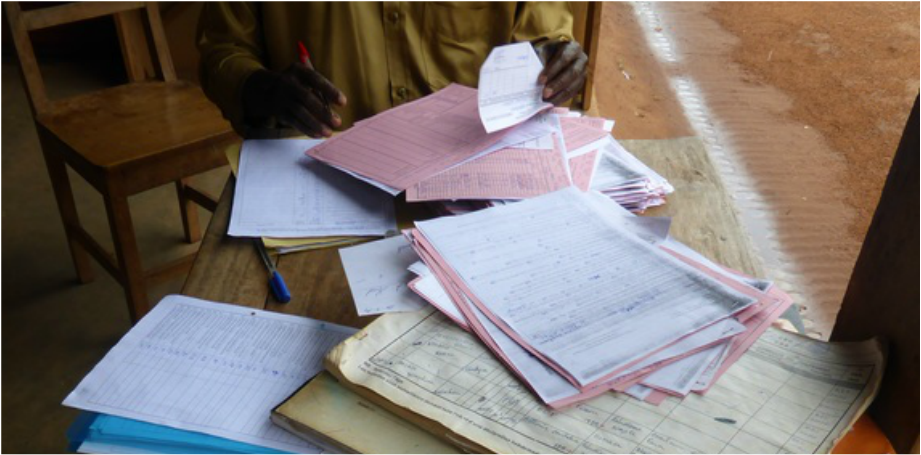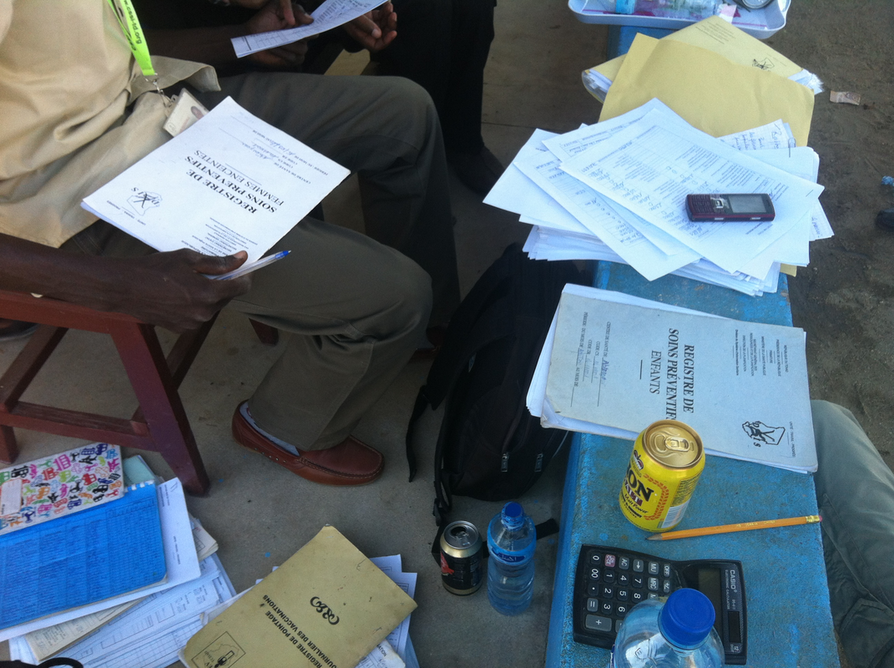L’humour pour faire évoluer les mentalités sur les questions de santé : tel est le sens de la collaboration qui lie désormais nos Communautés de Pratique et Damien Glez, dessinateur aux multiples talents et au coup de crayon percutant. Récemment récompensé par le Prix du dessin satirique politique du Museo Premio (en Italie), nous sommes allés à sa rencontre. L’occasion d’en savoir plus sur son parcours, son engagement ou encore sa vision du rôle du dessin satirique dans la démocratie africaine.
Tout d’abord, sur ta propre histoire, d’où vient cet intérêt au départ pour l’Afrique ? Quelle a été ton expérience en tant que coopérant à l’époque et comment est venu ton goût pour la caricature ?
Il y a eu d’abord mon intérêt pour le dessin, venu de ma tendre enfance, celle d’un enfant qui parlait si peu qu’il s’exprimait avec un crayon. Vers 12 ans, j’ai découvert la caricature et, à l’adolescence, l’intérêt pour l’actualité et son traitement journalistique. L’Afrique, j’y suis allé à la fin de mes études, à 23 ans, pour y faire une coopération de deux ans, essentiellement comme professeur d’allemand. Et j’y suis resté, ayant aujourd’hui passé plus de la moitié de ma vie au Burkina Faso. Moi qui n’avais pas l’ambition d’être dessinateur professionnel, j’ai débarqué à Ouagadougou en 1990, un an avant le retour de la République et donc la possibilité de s’exprimer dans un support de presse satirique…
« Le Journal du Jeudi » est devenu un incontournable dans le dessin satirique en Afrique. Comment s’est passée la construction du journal ? Quelles sont ses missions ? Comment a-t-il été accueilli, y a-t-il eu des difficultés ?
Le journal s’est construit progressivement, sans partenaire financier. Imprimés à crédit, les premiers numéros, en août 1991, se sont bien vendus et ont permis au journal de se structurer, de louer un siège au bout des quelques semaines, puis de payer des salaires, d’embaucher puis d’acquérir, en 2000, une petite imprimerie pour finir d’acquérir une indépendance complète. La mission est celle de décrisper la tension politique, de remettre les politiciens à leur place, de soulever les débats nécessaires à l’ancrage démocratique, de présenter l’actualité sous un angle décalé. Les difficultés ont été nombreuses –pressions politiques ou économiques-, mais c’est le seul journal satirique d’Afrique francophone qui a survécu 25 ans…
Tu es impliqué dans le réseau Cartooning for Peace, qui réunit des dessinateurs du monde entier afin de promouvoir la satire et la liberté d’expression. Peux-tu me parler de ton combat avec eux ? De ton intégration dans le réseau, la manière dont il fonctionne et les buts qu’il se donne et que toi-même tu te donnes à travers lui ?
Je suis effectivement membre de Cartooning for Peace qui réunit plus de 120 dessinateurs et je fais même partie des trois dessinateurs membres du Conseil d’administration. Nous tentons de réfléchir aux grands thèmes de la société actuelle, ou plutôt « des » sociétés actuelles, sans être limité à la grille de lecture d’une seule région du monde. Parmi des thèmes généraux comme la peine de mort ou le droit des femmes, nous traitons évidemment les sujets de la liberté d’expression et réfléchissons à notre métier de dessinateur de presse, de sa responsabilité, de ses limites, de ses impacts… Nous essayons de confronter les avis de dessinateurs de cultures différentes, au milieu du grand public invité lui-même à débattre plutôt que de participer à une certaine violence ambiante. À titre personnel, je peux, grâce à Cartooning for Peace, rencontrer mes collègues, sachant que notre métier est traditionnellement une activité solitaire.
Peux-tu me parler de ta vision du dessin humoristique dans la démocratie africaine ? Son rôle, son impact ?
Le dessin a une force spécifique dans des pays où la majorité de la population est analphabète ou alphabétisée dans des langues différentes. Et l’humour est un ressort fantastique pour contrer les autocrates. C’est tout naturellement qu’il permet de faire passer des messages via la presse satirique. Par ses non-dits et ses allusions graphiques, il permet de dire ce qui ne peut pas encore être écrit. Il est un cheval de Troie dans les régimes autocratiques…
Quels sont d’après toi les défis principaux qui demeurent quant à la liberté d’expression, la démocratie, la prise de conscience ? Quelles ont été les évolutions que tu as pu remarquer au cours de ta carrière ?
La situation de chaque pays est différente. De façon globale, les dessinateurs de presse sont pris dans un étau entre aridité économique et pression politique. Et le dosage est différent d’une nation à une autre. Au Burkina, deux ans après l’insurrection populaire qui fut la seule réplique des printemps arabes en Afrique noire, la liberté d’expression est maximale (le pays est mieux placé, dans les classements de liberté de la presse, que bon nombre de pays européens). L’enjeu, dans un pays sahélien pauvre, est surtout économique (dont les mêmes problèmes que la presse papier dans le reste du monde). Il est aussi celui de ne pas voir les populations être blasées et s’engager de moins en moins. Il y a évidemment des pays où les libertés ne sont pas encore abouties.
As-tu déjà rencontré des obstacles ou des réticences par rapport à ce que tu as pu dessiner ?
J’ai rencontré peu de réticences populaires, mais j’ai évidemment eu quelques bras de fer avec les autorités. Les autorités politiques (régimes de Blaise Compaoré, de Mohammed VI, de Ben Ali, etc.) et les autorités religieuses (confréries musulmanes sénégalaises). Là où je réside, rien de grave ne m’est arrivé, rien qui ne mette en péril mon intégrité physique et rien qui ne m’empêche de continuer de conquérir la liberté de dessiner.
Comment s’est construite ta collaboration avec Valéry Ridde et Ludovic Queuille ? Qu’en as-tu retiré ?
Longtemps sceptique vis-à-vis de ma capacité à servir le monde de la “sensibilisation” généralement réservée à des dessins purement illustratifs et politiquement correct, j’ai découvert avec grand intérêt la démarche de Valéry Ridde et Ludovic Queuille, notamment dans le domaine de l’accès à la santé gratuite. Pour la première fois, j’ai constaté que le débat sur les questions de santé pouvait, hors de la presse, passer par une certaine impertinence –impertinence salvatrice pour faire évoluer les mentalités dans ce secteur si souvent sinistré pour des raisons de stratégie, d’organisation, de manque de volontarisme. La caricature avait tout à coup parfaitement sa place. Une place constructive.
Tes activités sont nombreuses, jusqu’à la scénarisation de séries télévisées (comme Trois hommes, un village) ou la réalisation d’un BD-reportage en 2014 dans le camp de réfugiés de Breidjing. Peux-tu me parler de ces expériences ?
Ce sont des expériences différentes qui ont pourtant en commun de rendre compte, de manière personnelle et même décalée, du monde qui m’entoure. Une chanson est à la musique ce que le cartoon est au dessin : une forme elliptique et ramassée de montrer la réalité. Un BD-reportage est un ensemble de dessins de presse sous un autre format. Une série télé est bien souvent –celles que j’ai écrites en tout cas – une satire de la société. Ces activités sont finalement toutes des manières d’écrire et de décrire…
Y a-t-il un dessin dans ta carrière qui ressort par rapport aux autres, qui t’a marqué ?
Alors que le dessin d’actualité est par nature éphémère, certains ont une double ou une triple vie, sans qu’on l’ait imaginé avant. Il y en a un qui est régulièrement utilisé dans des publications sur la presse ou intégré dans des manuels scolaires. On y voit une Africaine qui évoque la nécessité de sauvegarder la presse écrite. Dans la deuxième partie du dessin, on comprend qu’elle est une vendeuse de poisson et qu’elle déclare « Avez-vous déjà essayé d’emballer du poisson avec un site internet ? ». Ce dessin est régulièrement repris, et il suscite souvent des réactions du public, sur les réseaux sociaux : des témoignages de mémorisation et des expressions d’affection.
Souhaites-tu rajouter quelques choses pour nos lecteurs ?
Souhaitons que le dessin de presse, technique d’expression assez ancienne – et donc éventuellement désuète – puisse toujours susciter l’intérêt du lecteur, à côté de la dictature de la pure illustration. C’est pourquoi les « cartoons » s’aventurent sur de nouveaux terrains comme le web et qu’ils investissent de nouveaux secteurs, comme celui de l’observation des questions de développement.