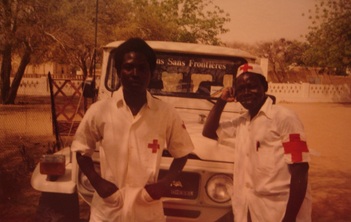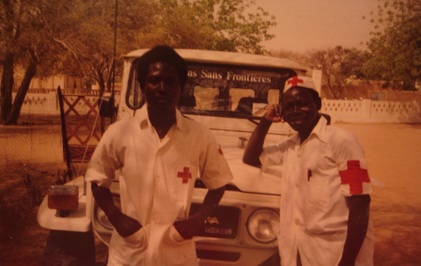Dans ce billet de blog, nous vous présentons un nouveau partenariat qui va consolider l’engagement des communautés de pratique dans la gestion des savoirs dans le domaine de la santé. Nous vous présentons la première activité de ce partenariat : une formation d’une journée en courtage des savoirs (Ouagadougou, 29/11/2013). D’autres activités suivront en 2014.
Construire des systèmes assurant une gestion optimale des savoirs est un des grands défis du monde contemporain. C’est en observant l’inefficience liée aux demandes d’assistance restant sans réponse ou au contraire générée par des missions redondantes, que les agences affiliées à HHA et les ministères de la santé ont suscité la création des communautés de pratique (CoPs). Cet espace, les CoPs ont rapidement appris à l’occuper, en veillant toujours à valoriser l’expertise détenue par leurs membres. Aujourd’hui les CoPs ont grandi en taille et gagné en stature ; leurs plateformes électroniques et événements sont reconnus comme des canaux importants de partage des connaissances.
Sur ces trois années, les facilitateurs des CoPs ont aussi accumulé une solide expérience en matière de gestion des savoirs. Cette expertise, ils sont désormais prêts à la partager (certains facilitateurs aident ainsi d’autres acteurs à conduire leurs propres événements), mais aussi à la transmettre au travers de formation.
Pour réussir ce nouveau programme d’activités, les CoPs HHA se sont associées avec deux acteurs qui ont démontré leur engagement en matière de gestion des savoirs en santé internationale: l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers et l’Université de Montréal.
Nos activités de formation
Notre programme d’activités sera flexible. Il sollicitera l’expertise académique présente chez nos deux partenaires académiques, mais mettra aussi en valeur l’expertise détenue par les différents facilitateurs des CoPs. Nos activités se feront en face-à-face, mais aussi par voie électronique.
Les thématiques couvertes seront notamment les suivantes : techniques de transfert des connaissances scientifiques vers les décideurs politiques, méthodologies de facilitation de communauté de pratique, usage des média sociaux, cadre d’évaluation des activités de gestion des savoirs…
Pour les activités en face-à-face, nous essayerons de nous rapprocher au maximum de nos experts. Si certaines de nos activités seront parfois organisées au Nord, nous essaierons d’organiser la majorité d’entre elle en Afrique, souvent en les accolant à d’autres événements.
A cette fin, nous sommes à la recherche de partenaires africains – académiques, mais aussi ONG ou entrepreneurs – disposés à organiser nos activités dans leurs pays. Car notre partenariat n’est bien sûr pas figé. Nous avons bon espoir de pouvoir progressivement nouer des liens avec d’autres acteurs. Le modèle des CoPs est clairement d’être ouvert à la collaboration. Nous espérons par ailleurs que ces techniques de gestion des savoirs seront progressivement adoptées par les institutions académiques africaines, ce qui élargira le champ des partenaires pour les CoPs.
Une première formation en courtage des savoirs
Notre première activité sera une formation d’une journée dans le domaine du courtage des savoirs scientifiques. Cette stratégie a pour but d'appuyer les pratiques et la prise de décision fondée sur les données probantes dans l'organisation, la gestion et la prestation des services de santé. Elle repose sur une personne ou une organisation dont la mission consiste à répondre aux questions des intervenants et des décideurs. C’est une option tout à fait envisageable pour un ministère de la santé, une agence internationale ou une organisation non gouvernementale. Pour les participants au cours, ce sera l’opportunité d’acquérir les connaissances théoriques et les techniques entourant le courtage des connaissances. Le cours est ouvert aux cadres des ministères de la santé, aux chercheurs, au personnel des partenaires techniques et financiers. Il est recommandé aux membres des CoPs qui aimeraient assumer dans le futur un rôle dans la co-facilitation des activités des CoPs. Cette formation sera offerte, le 29/11/2013, à Ouagadougou au lendemain de la conférence organisée par la Communauté de Pratique « Accès Financier aux Services de Santé » (25-28/11/2013). La formation, développée à l’Université de Montréal, sera assurée par une équipe expérimentée de trois formateurs : Christian Dagenais (Équipe RENARD, Université de Montréal), Julie Lane (Université de Sherbrooke) et Télesphore Donmozoun Somé (Société d’étude et de recherche en santé publique, SERSAP). Vous pouvez accéder au programme en cliquant ici. Pour le formulaire d’inscription à la formation, c’est ici. Grâce à un financement des Instituts de Recherche en Santé du Canada et de la Commission Européenne (Projet FEMHealth), ce cours sera gratuit. Dépêchez-vous nous n’accepterons que 20 participants.