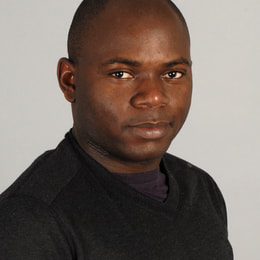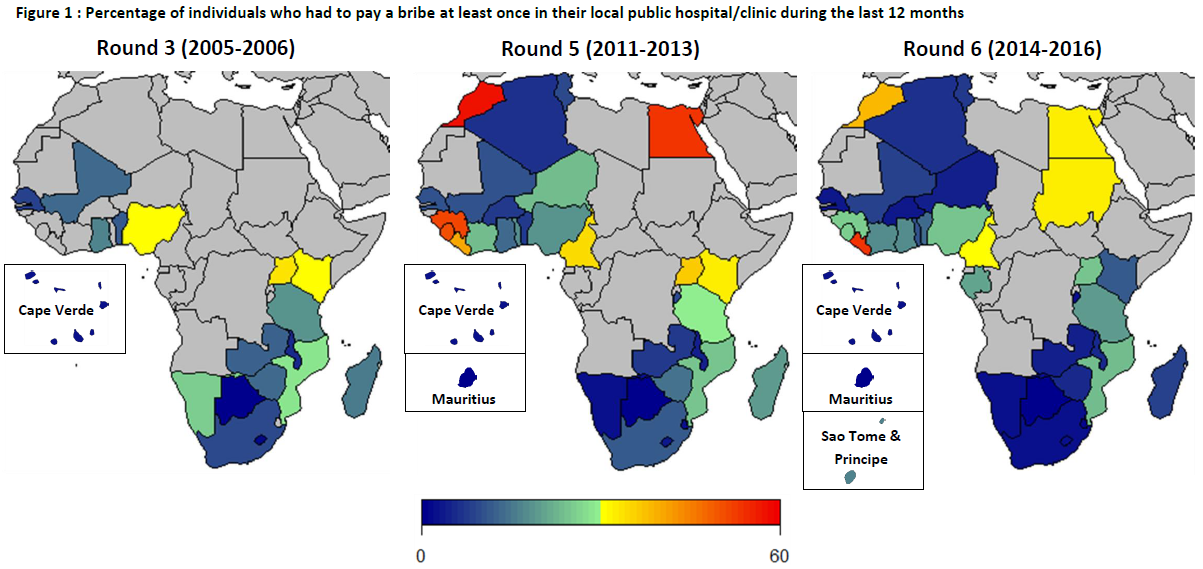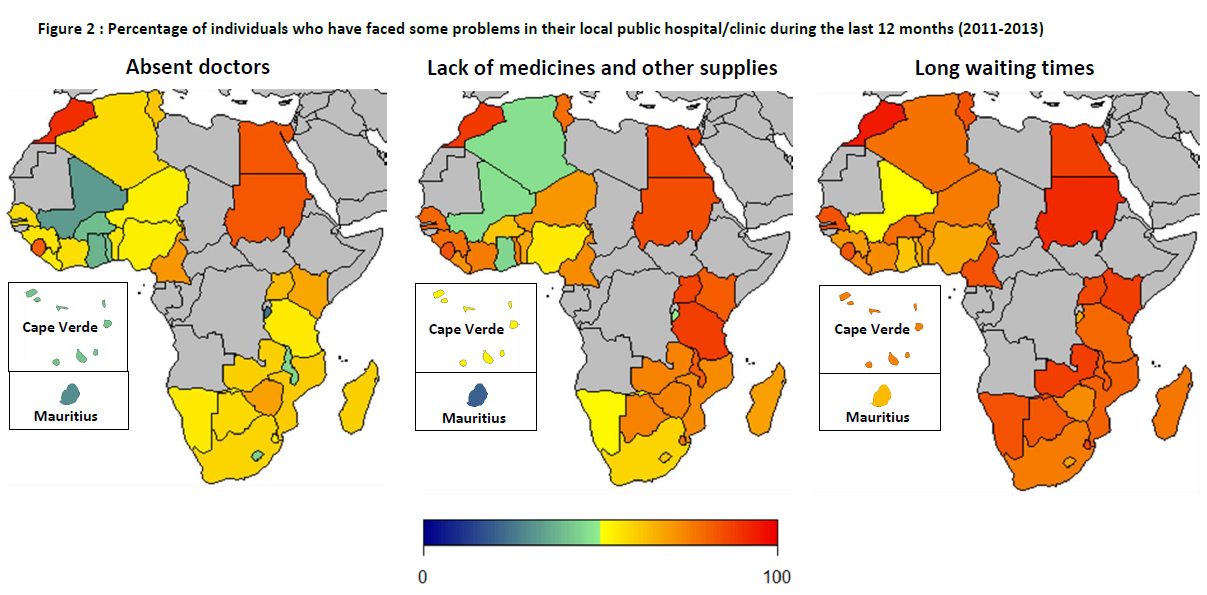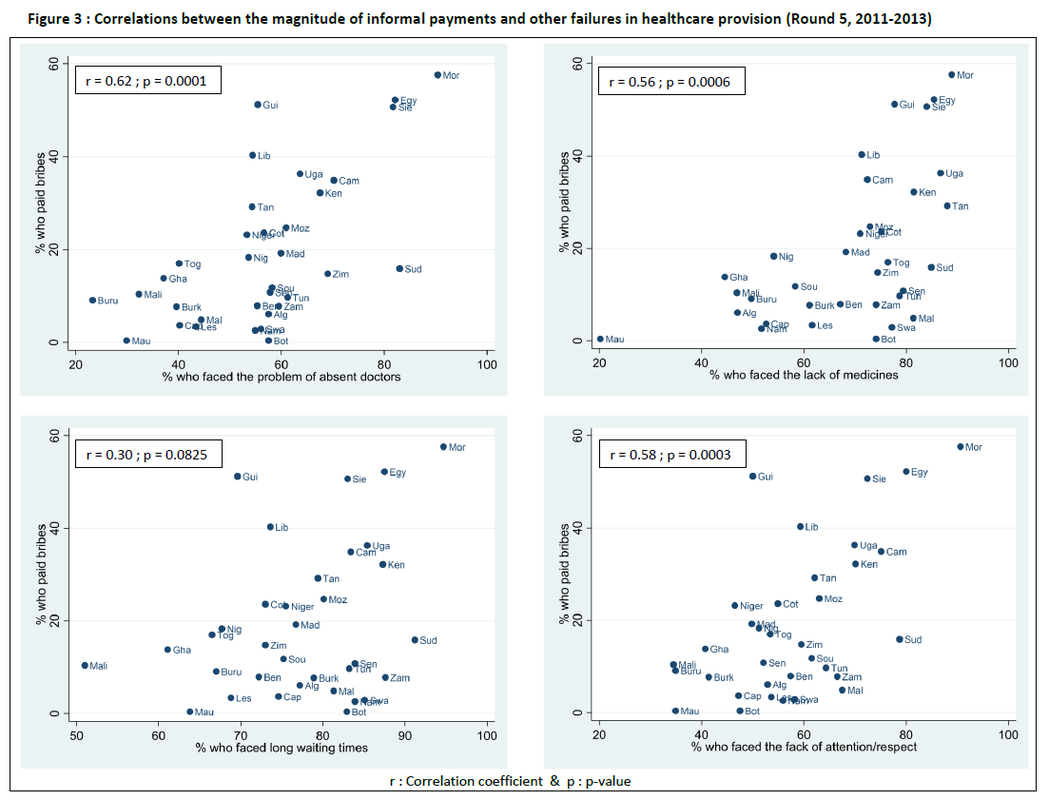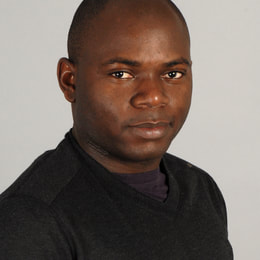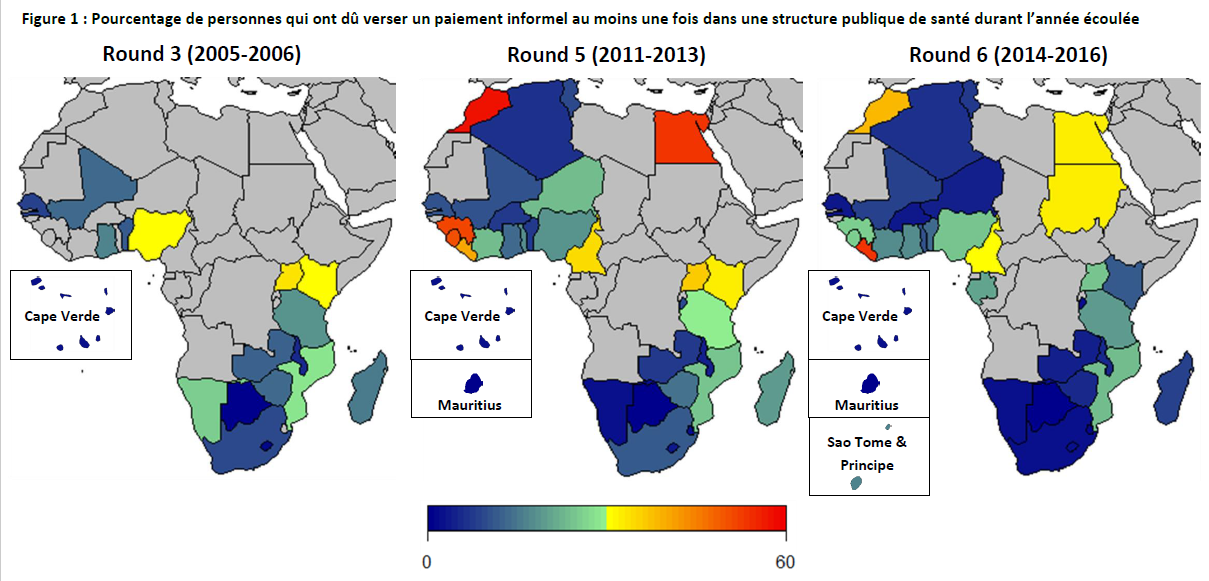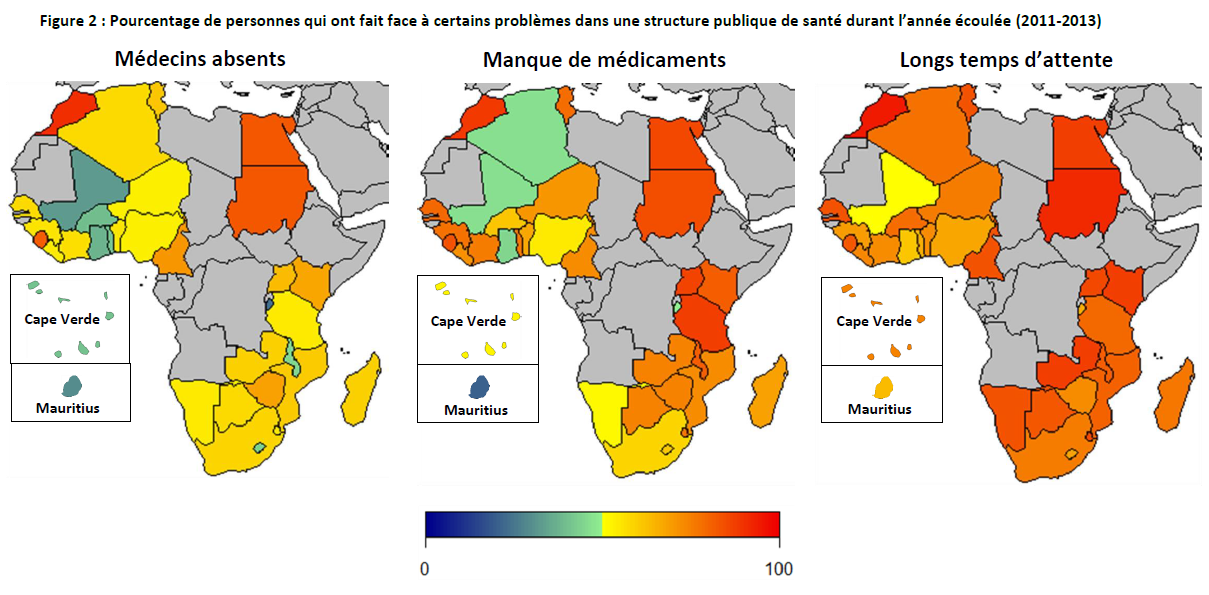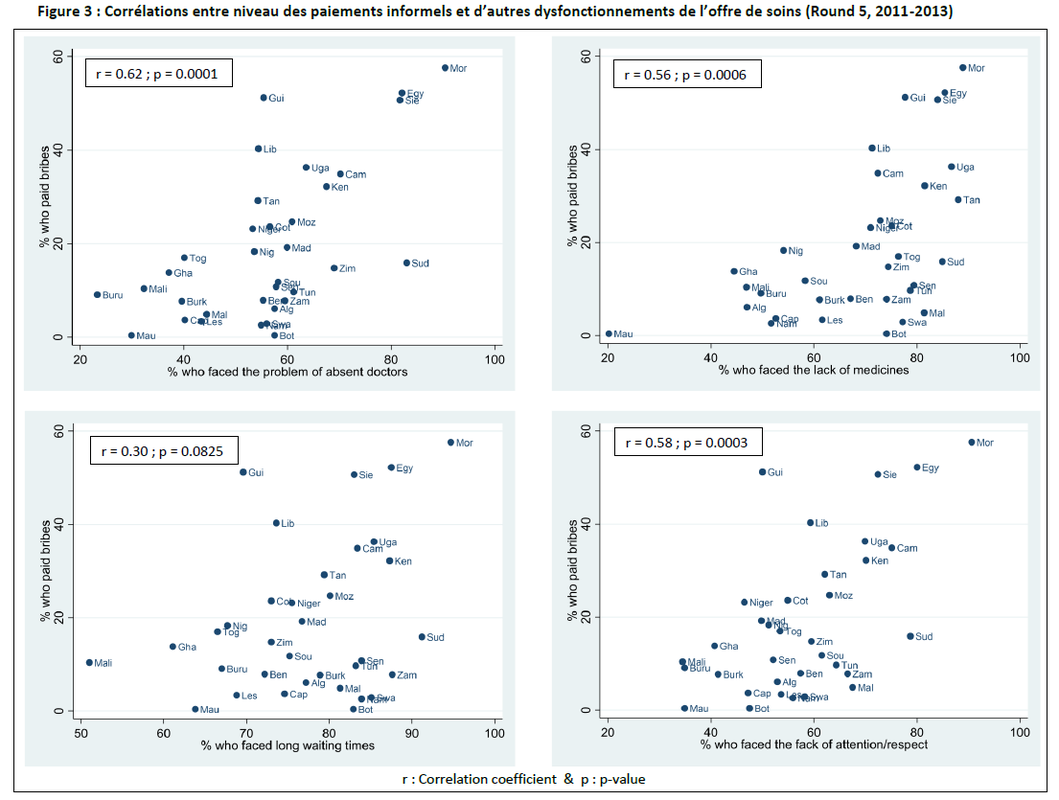Les responsables chargés de la mise en œuvre du FBP savent généralement que la vérification est coûteuse, tant sur le plan financier que sur le plan économique. Cependant peu d’entre eux connaissent son coût exact. Des articles récents sur l’Afghanistan (1), la Tanzanie (2) et le Benin (3) ont souligné le coût financier de la vérification. Mais, force est de constater que le peu de données publiquement disponibles ne permet pas de tirer des conclusions plus générales. En l'absence de données, d'autres publications ont tenté d’évaluer le coût de la vérification en s’appuyant sur le niveau d'effort fourni par les vérificateurs comme approximation. Quoi qu'il en soit, les acteurs travaillant sur le FBP savent que la vérification est une question sur laquelle il faut travailler pour améliorer la viabilité de ce mécanisme.
La vérification est nécessaire dans tous les mécanismes de financement basé sur les outputs
Dans tout arrangement contractuel instaurant un paiement des prestataires basé sur ses résultats (4) (paiement à l'acte, groupes homogène de maladie), une certaine forme de vérification doit être effectuée. Elle est généralement effectuée dans le cadre du processus de traitement des demandes de paiement. Au Kirghizistan par exemple (5) le système de paiement hospitalier du Fonds d'assurance maladie obligatoire comprend des revues d'utilisation de services par les patients, de gestion et d'assurance de la qualité. La sélection des dossiers (cas) à vérifier se fait en fonction d'un ensemble de critères.
La vérification dans le FBP ou la rémunération à la Performance (P4P) ne devrait, en principe, pas être différente. Dans le cas des programmes P4P aux États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs, la vérification est fondée sur les données transmises par les prestataires à la base de données de l'acheteur, ainsi que sur des sondages anonymes auprès des patients.
Quelques idées pour expliquer pourquoi la vérification est coûteuse dans le contexte des PRFI
Le coût de la vérification semble élevé dans les Pays à Revenu Faible et Intermédiaire (PRFI) pour quatre raisons. Tout d'abord, dans la majorité des contextes dans lesquels elle est mise en œuvre, la vérification souffre d’une faible mobilité des données. En effet, l’acheteur doit le plus souvent aller chercher les données sur le terrain, puisque la chaîne de d’information allant des dossiers des patients aux registres en passant par les bases de données nationales n'est pas entièrement numérisée. Deuxièmement, la plupart des programmes PBF commencent par vérifier l’ensemble des établissements de santé pour chaque période de paiement. Troisièmement, la vérification a souvent été conçue comme un processus à part entière et faiblement intégré dans un système plus global de supervision et d'audit de la qualité. Quatrièmement, parce que le FBP ne paie qu’une partie du coût des services. Ainsi, les décaissements sont moins élevés, en comparaison aux régimes qui paient la totalité du coût des soins (6). Par conséquent, le coût de la vérification est relativement plus élevé (7). Cela est particulièrement vrai dans les contextes des PRFI où le FBP est le seul mécanisme actif de paiement des prestataires pour lequel les résultats doivent être vérifiés.
La plupart, voir la totalité, de ces raisons évoluent avec le temps.
Transition à faire: aller vers une vérification rétrospective ciblée tout en valorisant les données pour la gouvernance
En ce qui concerne le coût de la vérification, il se peut que nous utilisions souvent le mauvais dénominateur pour calculer le coût. Plutôt que de comparer étroitement le coût de la vérification aux paiements du schéma FBP versés aux établissements de santé, nous devrions penser davantage au financement global des établissements de santé. La vérification, en particulier la vérification de la qualité, porte généralement sur un large échantillon de l'offre de services et non pas simplement sur celle ciblée par le schéma FBP. Fait tout aussi important, elle a contribué à bâtir une culture où les données sont utilisées pour la prise de décisions et où l'information est liée aux ressources.
La vérification peut jouer un rôle déterminant dans l'institutionnalisation de la culture du savoir et du financement et de la prestation de services de santé fondés sur des données probantes. Avec l'officialisation des mécanismes et des procédures d'examen et de reconnaissance des résultats en matière de santé, la vérification met en évidence le rôle central des données probantes sur la qualité et la quantité dans la prestation des services de santé, tant pour les prestataires que pour les gestionnaires. L'investissement dans une vérification adaptée contribue à renforcer la gouvernance de la santé tout en améliorant la responsabilisation dans la prestation des services. Comme dans le cas des autres approches de renforcement des systèmes de santé, l'évaluation du coût de la vérification doit tenir compte de l'intérêt d'améliorer la gérance sectorielle, en plus du rapport coût-efficacité immédiat de la vérification en soi.
En ce qui concerne la portée de la vérification dans le FBP, le contrôle de tous les établissements de santé lors de chaque période de paiement (qui est mensuelle dans certains pays) était un point de départ nécessaire pour s'assurer que tous les prestataires de soins comprennent les règles du jeu. Dans de nombreux contextes, le FBP s'éloignait en effet considérablement de ce qui prévalait auparavant, où l’achat passif, c'est-à-dire le respect d'un budget prédéterminé ou le simple paiement de factures lorsqu'il était présenté, prévalait. Des premières études portant sur la vérification dans le FBP ont montré que les établissements de santé comprennent les règles du jeu après environ deux ans de mise en œuvre. Cette meilleure compréhension entraine le plus souvent une diminution notable des cas de sur- et sous-déclaration. Une évolution de la pensée des acteurs intervenant dans le FBP est qu’une vérification plus ciblée (ne reposant pas sur la totalité des établissements de santé) est envisageable dès lors que le nombre moyen de déclarations erronées est parvenu à un niveau jugé acceptable par l’acheteur. A l’évidence cette nouvelle modalité de vérification devra être adaptée à chaque contexte.
En Argentine, la méthode de vérification utilisée consiste à cibler les formations sanitaires présentant les volumes d’activités les plus élevé et pour lesquelles des visites plus régulières seront effectuées. Au Zimbabwe, le ciblage des formations sanitaires repose sur le volume d’activités et l'historique des déclarations erronées. Les vérificateurs se focalisent alors sur les établissements de santé « récidivistes » (c.-à-d. présentant le plus fréquemment des déclarations erronées). Cette dernière méthode est communément appelée vérification basée sur le risque. Notons, qu’il n'existe pas de méthode unique de vérification basée sur les risques, et diverses méthodologies ont été étudiées dans les pays (de plus en plus nombreux) souhaitant s'appuyer sur l'expérience du Zimbabwe.
La plupart des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire inférieur ont numérisé leur base de données nationales d'information sanitaire sur la prestation de services. Dans de nombreux cas, ceci est basé sur la plate-forme DHIS2. Des efforts sont en cours dans de nombreux pays, y compris ceux qui ont mis en place des programmes FBP, pour aller plus loin dans la numérisation des dossiers de patients et faire en sorte que ces plates-formes alimentent directement des bases de données sanitaires au niveau national. Ce processus prendra du temps, car il se heurte à des ressources financières limitées et à des problèmes d'infrastructure. Le fait d'avoir des données exactes et à jour peut nécessiter de lourds investissements, mais leur valeur ne peut être surestimée. Les données utilisées pour les paiements devraient être au cœur d'une base de données sur l'activité des patients qui peut révéler beaucoup de choses sur les modes d'utilisation des services et les résultats dans un pays. Ces données peuvent être utilisées à la fois pour le paiement, l'amélioration de la prestation des services et pour orienter les politiques. Les données utilisées pour le paiement des services individuels fournis devraient viser à devenir plus sophistiquées, en se basant sur le respect des protocoles de traitement. Les données devraient également être utilisées pour évaluer les questions de politique, comme l'endroit où les services devraient être consommés et le nombre de points de services qui devraient exister. Les pays qui mettent en œuvre le schéma FBP devraient envisager de passer d'une vérification binaire (oui/non) de la prestation des services axée sur les fonds du schéma FBP à des méthodes d'examen rétrospectif des cas présentant un bon rapport coût-efficacité, dans le cadre d'un système de paiement mixte cohérent.
- Cashin, Cheryl; Fleisher, Lisa; Hashemi, Tawab. 2015. Verification of Performance in Results-Based Financing: The Case of Afghanistan. Health, Nutrition and Population Discussion Paper;. World Bank, Washington, DC
- J. Borghi et al., “In Tanzania, The Many Costs Of Pay-For-Performance Leave Open To Debate Whether The Strategy Is Cost-Effective”, Health Affairs 34, no. 3 (March 1, 2015): 406–14, voir ici.
- Matthieu Antony, Maria Paola Bertone, and Olivier Barthes, “Exploring Implementation Practices in Results-Based Financing: The Case of the Verification in Benin,” BMC Health Services Research 17, no. 1 (April 2017), voir ici.
- John C. Langenbrunner, Sheila O’Duagherty, and Cheryl S. Cashin, eds., Designing and Implementing Health Care Provider Payment Systems: “How-to” Manuals (The World Bank, 2009), voir ici.
- J. Kutzin et al., “Innovations In Resource Allocation, Pooling And Purchasing In The Kyrgyz Health System”, Manas Health Policy Analysis Project, August 2002, voir ici.
- Or at least a cost agreed to mostly by the purchaser and somewhat by the provider as being acceptable.
- Assuming the cost to verify is the same whether the purchaser pays partial cost or full cost.
- RESYST, “What is strategic purchasing for health?” Topic Overview 4, 2014.
- Petra Vergeer et al., “Verification in Results-Based Financing for Health”, World Bank Discussion Paper, December 2016.
Tous les auteurs font partie du groupe de travail Collectivity sur la vérification dont l'objectif est d'aider de nourrir la réflexion sur la façon d'adapter les approches de vérification aux circonstances des PRFM, y compris ceux qui ont une faible densité de population ou qui sont affectées par les conflits. Les résultats de ce groupe ont jusqu' à présent donné lieu à un atelier à Bruxelles, dont les résultats feront l'objet d'un rapport qui sera publié prochainement. Par ailleurs, un webinaire s'est tenu en français sur ce sujet, un autre étant prévu prochainement en anglais. La principale publication à venir, sera un rapport sur une enquête réalisée dans six pays qui explorera les modalités avec lesquelles la vérification est mise en place aujourd'hui, quelles sont les innovations déjà en place et les réflexions des représentants de ces pays autour des évolutions à l'avenir en matière de FBP et de vérification. Nous espérons que le travail de ce groupe informera les praticiens du monde entier afin qu'ils apportent une évolution dans la manière dont la vérification est effectuée.