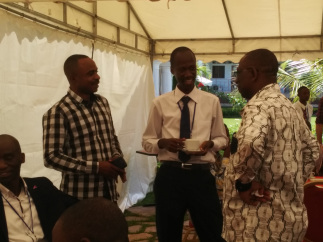Pour beaucoup d’entre nous, le mois d’août aura probablement été celui de la prise de conscience : cette épidémie d’Ebola est vraiment différente des précédentes. Les semaines avancent et le drame se déroule, au Liberia, en Sierra Leone, en Guinée et dans des zones plus reculées en RDC. Ainsi, au Liberia, durant la semaine du 1 au 7 septembre, plus de 400 cas confirmés et suspectés ont été enregistrés, un nombre qui représente presque le double des nouveaux cas déclarés la semaine précédente. Dans ce pays, la transmission du virus s’accroit à un rythme exponentiel. On sait aussi que ces chiffres, collectés par le système de santé, sont inférieurs à la réalité.
Le lourd tribut payé par le personnel soignant rend le défi encore plus effrayant. En RDC, en date du 9 septembre, parmi les 35 décès, il y avait 7 personnels de santé. En Guinée, à la date du 14 septembre 2014, 60 personnels de santé avaient déjà été infectés parmi lesquels 30 décès ont été enregistrés. Un chercheur de Guinée nous a rapporté la semaine dernière que dans son pays, un obstétricien, deux sages-femmes et un jeune stagiaire avaient été infectés lors d’un accouchement. Ce sont les systèmes de santé dans leur intégralité qui sont bloqués – au Libéria et en Sierra Leone, à cause des systèmes de santé à l’arrêt, on meurt aujourd’hui de malaria ou lors de l’accouchement.
Nous observons tous aussi la grande lenteur et l’insuffisante ampleur de la réponse de la communauté internationale. Ebola fait peur, aussi aux nombreux acteurs, qui normalement affluent lors des crises humanitaires. Médecins Sans Frontières, organisation en pointe contre cette maladie, appelle à l’aide : ils sont dépassés. Au Nord, nous observons des réflexes inspirés par la peur et l’égoïsme : certains disent « gardez ces malades loin de nous » !
Que pouvons-nous faire ?
Cette situation interpelle fortement les équipes de facilitation des Communautés de Pratique (CoPs). Nous savons que certains membres des CoPs sont basés dans les pays touchés. Nous savons que dans les pays voisins, un grand nombre de prestataires sont déjà impliqués dans la préparation de la réponse du système de santé, au cas où de premiers cas venaient à survenir. D’autres membres sont aujourd’hui plus loin du champ de bataille, mais nous devinons que nous serons tous prochainement bien plus impliqués dans la guerre contre Ebola, car malheureusement la situation va empirer.
Notre message tient en peu de mots: nous sommes prêts à engager les CoPs dans la lutte contre Ebola. Mais nous voulons être utiles. Il ne s’agit pas de prétendre pouvoir faire ce que nous ne pouvons pas faire, donner des avis inutiles (car fournis depuis notre bureau) ou ajouter du bruit au chaos. C’est donc à ceux qui sont actuellement et au quotidien sur le terrain, à guider les CoPs.
Premières pistes
Nous pensons que le mieux que nous puissions faire c’est d’être à l’écoute des besoins des acteurs impliqués quotidiennement dans les systèmes de santé, et ceux du personnel de santé en particulier.
Peut-être pouvons-nous aider à faire remonter vos messages et témoignages ? Notre hypothèse est qu’aujourd’hui, plus que jamais, les acteurs présents sur le terrain doivent être entendus. Quels sont les défis que vous rencontrez ? Qu’observez-vous ? Quelle bonne pratique avez-vous identifiée ? Comment dans votre district, votre hôpital, s’organise la réponse ? Est-il possible d’améliorer la réponse des partenaires extérieurs (et par exemple éviter les gaspillages)? Nous pensons que les forums en ligne que nous avons établis pourraient être utiles à cette fin.
Une deuxième piste est l’expertise détenue par les 3.000 experts inscrits dans nos CoPs. A titre d’exemple, une experte travaillant pour une agence internationale nous a contacté récemment pour qu’on lui fournisse un appui sur la rédaction d’une note conceptuelle pour une stratégie de motivation du personnel au Liberia (le personnel de la santé a récemment fait grève, vu les risques auxquels ils font face aujourd’hui). Nous avons rapidement sollicité plusieurs experts seniors de la CoP FBP. Ils ont rendu leurs avis sur la note initiale. Ils ont délimité ce qui était possible avec des mécanismes de financement et ce qui relevait d’autres mécanismes. Ce service d’expertise, nous pouvons peut-être l’offrir à d’autres. Nous pensons notamment aux ministères de la santé.
Cette première expérience de consultation ‘express’ a aussi révélé que certains d’entre vous aviez une expérience concrète dans la réponse à Ebola. Nous les avons invités à partager leur expertise sur nos forums. Nous espérons donc, dans les semaines qui viennent, publier leurs contributions. Cela pourrait être une 3° piste pour nos contributions. Nous voyons en particulier un besoin important de réflexion et d’action en matière de santé communautaire. Comment entendre les voix des populations, mobiliser leurs ressources et les encourager à élaborer et mettre en œuvre leurs propres stratégies de riposte?
Enfin, nous allons veiller à ce que nos forums servent d’espace de discussion et de partage de documents techniques. Sur le forum en ligne de la CoP "Planification et Budgétisation des Systèmes de Santé", les experts discutent actuellement de la pertinence d’organiser les journées nationales de la vaccination en Côte d’Ivoire, pays frontalier du foyer de l’épidémie. Les membres de la "CoP Médicaments E-med" ont échangé plusieurs messages sur le sujet. La CoP Prestation des Services de Santé a déjà publié plusieurs billets de blog et une liste de 5 lectures utiles . Nous allons maintenir cet effort.
Plusieurs d’entre nous serons à Cape Town, pour le symposium « Health Systems Research ». Lors de notre session en face-à-face le lundi 29 septembre, nous essayerons de faire aussi le point sur Ebola. D’ici là, nous vous invitons à réagir. Si vous nous confirmez que les CoPs ont un rôle à jouer et que nous parvenons à bien délimiter ce dernier, la mise en place d’une task-force inter CoPs sera la première étape. Nous chercherons alors des volontaires pour renforcer la coordination.
Nous vous invitons à laisser un commentaire en bas de ce blog ou de réagir sur le forum de votre CoP.