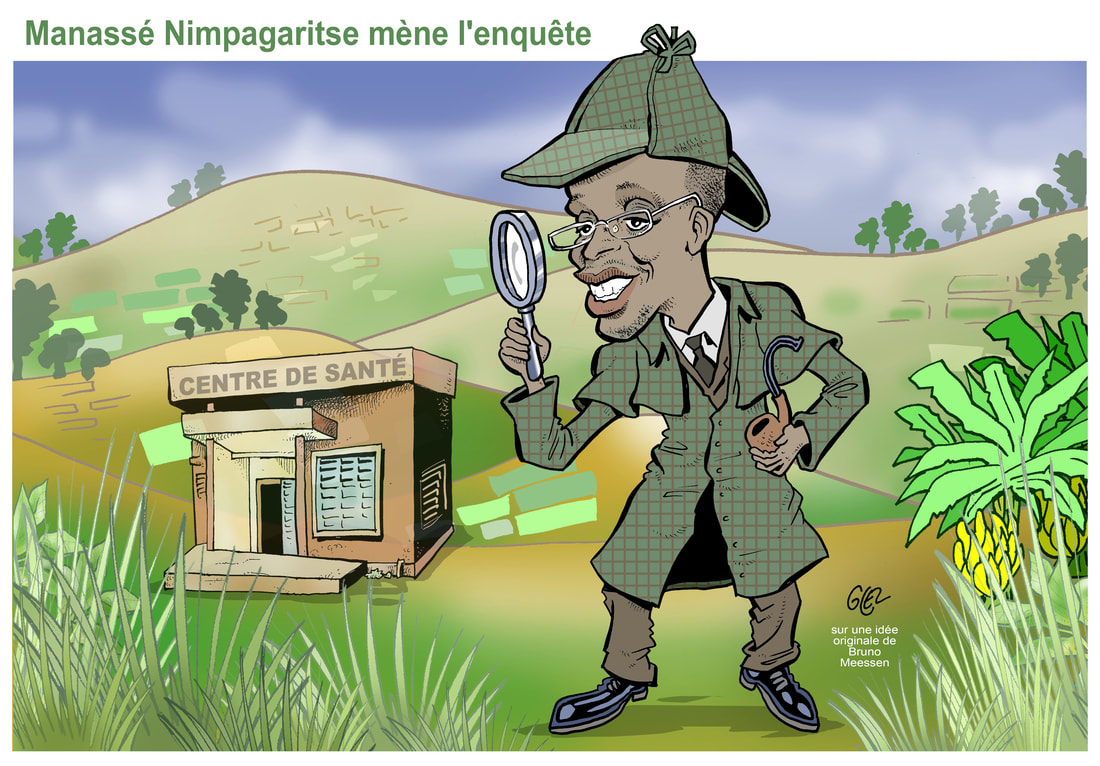Le blog Health Financing in Africa lance un nouveau projet: la "chaîne des docteurs". Le principe est simple à comprendre: Hyacinthe Kankeu avait été interviewé apres la défense de sa thèse sur la corruption. Aujourd'hui, c'est à son tour de poser quelques questions à Manassé Nimpagaritse, qui vient d'obtenir le titre de Docteur en Santé Publique à l'Université Catholique de Louvain. Si vous êtes thésard et votre recherche sur le financement de la santé en Afrique touche à sa fin, n'hésitez pas a nous contacter... Peut-être serez vous le suivant dans la chaîne!
Je vois peut-être quatre principales leçons. Une premiere réside au niveau de la capacité des personnels de santé à agir et à s'adapter. Ils ont leur propre regard sur le FBP, leur propre 'prise en main'. Ils savent par exemple aller chercher les informations utiles dans le contrat de rémunération pour établir leur propre stratégie. Ils savent apprécier la marge de manœuvre existant à leur niveau - ils vont prendre des initiatives, mais pas nécessairement celles prévues par le programme. Comme je le montre dans ma recherche, il y a une conjonction de mécanismes qui entrent en jeu pour permettre l’atteinte des résultats. Il est remarquable que cette capacité agissante opère même dans le contexte difficile des dernières années au Burundi. Les centres de santé ont par exemple réussi à améliorer la prise en charge des enfants malnutris en dépit de ruptures de stock. Je pense que cette capacité des personnels de santé à trouver des solutions est traditionnellement trop peu considérée dans nos interventions sanitaires: ces dernières sont construites sur l'idée qu'ils doivent juste exécuter ce qui a été décidé par d'autres.
Le deuxième message - et ce n'est pas une surprise - est que la malnutrition est un défi important pour les systèmes de santé et pour le FBP. S’il est vrai que dans le contexte burundais, des résultats ont été obtenus, il est clair que ça ne s’est pas passé nécessairement comme attendu (résultats de l'étude d'impact ici). Le FBP-nutrition a amélioré la prise en charge au niveau des centres de santé, mais n'a pas engendré de gains au niveau populationnel. Toutefois, il a permis que les défis soient mieux connus des partenaires, aussi bien de ceux qui étaient déjà impliqués, que de ceux qui ne l’étaient pas et qu’ils sentent alors la nécessité d’agir. L’implication pour d'autres pays qui seraient intéressés à appliquer le FBP à la malnutrition est la nécessité de faire avant toute extension du FBP à la malnutrition, un très bon état des lieux des capacités techniques au niveau des formations sanitaires et du système de santé. Dès l'analyse des données de l'étude de base (ici), nous avions en fait compris que cela allait être compliqué.
Le troisième message - de nouveau, ce n'est pas un scoop - est que le contexte de fragilité et d’instabilité peut constituer un frein à l’atteinte des résultats escomptés avec le FBP. Les pays fragiles et post-conflit font souvent face à des dysfonctionnements des systèmes de santé en général et des ressources en particulier, de façon telle que la seule stratégie FBP ne puisse trouver des solutions magiques. On peut par contre apprécier sa capacité à mettre le doigt sur les faiblesses - par exemple, la faible capacité au niveau des centres de santé à assumer une prise en charge intégrée des maladies de l'enfance.
La quatrième leçon est plus méthodologique: l’investigation à base d’une théorie de changement permet de mieux comprendre les raisons pour lesquelles le programme a marché d’un côté et ce qui n’a pas marché de l’autre. Le FBP n'est pas mis en œuvre dans le vide: il opère dans le cadre d'un système de santé caractérisé par la complexité; à ce titre, il n’est qu'une pièce d'un plus grand casse-tête. Ainsi, il est clair que la stratégie FBP exige souvent d’autres réformes qui vont au-delà de la simple introduction d'un mécanisme de paiement différent. La non-linéarité de notre théorie de changement finalisée (celle qui a été établie après intégration de nos résultats empiriques) montre que toute intervention telle que le FBP est complexe, car liée à toute une série de facteurs aussi bien internes qu'externes; d’où l’importance de tenir compte de la pensée systémique dans la théorie des programmes en considérant des facteurs contextuels et les réalités complexes et imprévisibles qui influent parfois sur les processus et les résultats d’un programme.
Revenons sur ta deuxième leçon. Quels sont les éléments de contexte propres au Burundi qui ont influencé, dans un sens ou dans l’autre, la mise en œuvre et les résultats de ce programme FBP-nutrition? Quelles leçons peut-on en tirer pour les autres pays africains, en particulier ceux qui font face à des fragilités similaires?
Depuis son accession à l’indépendance en 1962, le Burundi a connu une série de conflits armés respectivement en 1965, 1972, 1988 et 1993. Le dernier a été le plus long et le plus meurtrier, affectant aussi le système de santé, en particulier sur les volets infrastructures sanitaires et ressources humaines. Une relative stabilité a été retrouvée avec l’Accord d'Arusha signé en août 2000. Il a permis de nouveau l’organisation des élections démocratiques en 2005. Toutefois, le pays a plongé de nouveau dans une crise socio-politique à la suite de l’organisation des élections de 2015. Ainsi, le Burundi est resté parmi les pays les plus fragiles en 15e position parmi les 178 classés selon l’Indice de fragilité des états de 2016.
Le Burundi est l’un des pays les plus pauvres du globe. Ainsi, pour assurer l’accès aux soins aux populations, le Burundi a mis en place, depuis 2006, une mesure d’exemption des frais d’usager pour les enfants de moins de cinq ans, les accouchements et plus tard en 2010, les pathologies sur grossesse. Cette mesure fut fusionnée avec la stratégie de FBP après quatre années de mise en œuvre à titre pilote de cette dernière.
Cette stratégie FBP couplée à la gratuité des soins prenait ainsi en compte un certain nombre d’activités du Paquet Minimum d’Activités des centres de santé avec un focus particulier sur les activités en rapport avec la santé maternelle et infantile, comme d’ailleurs pour la plupart des montages FBP au stade initial. Cependant, les activités en rapport avec la prévention et la prise en charge de la malnutrition n’étaient pas considérées dans le paquet contractualisé, en dépit de la forte prévalence de la malnutrition au Burundi.
On voit donc que le contexte de ces dernières années a très fort joué dans le choix des objectifs sanitaires et le calibrage de la politique de financement dans la santé dans mon pays. C'est bien sûr une bonne chose. Je pense que c'est à bon escient que la malnutrition n'avait pas été directement intégrée dans le FBP - c'est un problème vraiment complexe à traiter, tant il est multifactoriel. Le pays ayant passé à l'échelle le FBP depuis trois ans, on pouvait espérer que le système FBP était prêt quand en 2013 la decision fut prise d'intégrer les services de nutrition dans le FBP. Mais on a peut-être sous-estimé combien le contexte restait contraignant.
De fait, la disponibilité des intrants pour la prise en charge de la malnutrition aigüe modérée (MAM) a été problématique tout au long de l’intervention. Le problème est déjà survenu juste au moment d’enclencher le démarrage de l'intervention par une annonce de la décision du Programme Alimentaire Mondiale (PAM) en 2014 de ne plus fournir d’intrants de la MAM (CSB, huile et sucre) sauf dans deux provinces. Ceci dit en passant, je me réjouis que le Prix Nobel de la Paix ait été décerné à cette agence des Nations Unies - au Burundi, nous avons malheureusement pu constater combien ses ressources sont trop limitées. À l'époque, l'annonce de retrait a été un coup dur aussi pour l'intervention, puisque cette contrainte n'avait pas été envisagée au moment de la rédaction du protocole de recherche. Pour en atténuer les conséquences, il a été décidé en octobre 2014 d'adapter l'intervention et de revoir à la hausse le barème de l’indicateur 'dépistage et prise en charge de la MAM' jusqu'à un montant qu'on espérait assez rémunérateur pour permettre aux Centres de Santé (CDS) d'acheter ces intrants localement (une solution conforme à la recommandation standard des programmes FBP de permettre aux établissements de santé de choisir leurs fournisseurs). Cependant, quelques jours avant le début de l'intervention, le programme en charge de la gestion de la malnutrition du Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA (MSPLS) - le PRONIANUT- a changé d'avis et n'a pas permis cet achat décentralisé par chaque CDS, par crainte de ne pas être en mesure de gérer le contrôle qualité. Ce problème a eu un impact sur l'intervention jusque fin décembre 2015 à l’aboutissement du processus de sélection par le PRONIANUT d’un seul fournisseur d’intrants de la MAM pour l'ensemble du pays. C’est en janvier 2016 qu’ont enfin eu lieu les premières livraisons d’intrants aux CDS intervention dont les commandes devaient être effectuées via les bureaux de district à un rythme trimestriel. Le deuxième lot de livraisons (comprenant aussi les CDS contrôle) ne pouvaient ainsi être possibles qu’en avril 2016. Cependant, les problèmes n'étaient pas terminés. En mai 2016, des problèmes de qualité des farines ont été signalés. En conséquence, l'approvisionnement par le fournisseur local a été temporairement suspendu et n'a repris qu'en septembre 2016, à peine trois mois avant la fin de l'intervention en décembre 2016.
L'autre élément contextuel non prévu a été la crise sociopolitique qui a éclaté dans le pays en avril 2015. En effet, celle-ci a conduit certains bailleurs de fonds, dont ceux participant au financement du FBP couplé à la gratuité des soins, à revoir leurs modes de coopération avec le Burundi. L'Union Européenne et les pays européens ont activé l'article 96 de l'accord de Cotonou en octobre 2015; ce qui a conduit à l'interruption de plusieurs programmes d'aide et à la réorganisation institutionnelle d'autres. Ainsi, cette situation s'est traduite par des déficits et des arriérés d’impayés des différents régimes de financement des services de santé (le FBP couplé à la gratuité et la Carte d’Assistance Maladie) cruciaux pour les ressources au niveau des CDS.
Il est ainsi clair qu'un contexte de fragilité expose à un basculement de la situation d’un moment à l’autre, parfois avant même le démarrage d'une intervention, souvent durant sa mise en œuvre. Ceci suggère qu'il faut concevoir des interventions pouvant être adaptées, que ce soit par les opérateurs nationaux ou par les acteurs de première ligne, on retombe ici sur ma premiere leçon. Pour les initiateurs d'une intervention, il demeure crucial d'avoir une bonne compréhension de ce qui se passe autour de soi, d'où ma recommandation de faire une mise en carte de la situation de départ, y compris des interventions conduites par les autres acteurs: le fait que même des acteurs humanitaires solides comme le PAM et l'Union Européenne subissent la fragilité montre que le défi est immense. Mais au final, je ne vois pas de solution miracle. Les crises socio-politiques exposent nos contextes au phénomène de volatilité de l’aide. Parallèlement au processus d’élaboration des programmes de renforcement des systèmes de santé, une attention particulière doit être portée également sur les dispositifs de gouvernance susceptibles de rassurer les bailleurs.
Dans tes travaux, tu as trouvé un impact positif de l’intervention FBP-nutrition sur des indicateurs tels que le nombre de cas de malnutrition aiguë détectés et pris en charge au niveau des centres de santé, ainsi que le taux de guérison. Cependant, tu notes une absence d’effet, voire une détérioration pour ce qui est de la prévalence de la malnutrition aiguë au niveau communautaire. Comment expliquer cette dichotomie entre les deux niveaux d’analyse?
Pour ma thèse, j’ai mis un focus particulier sur les activités de prévention et prise en charge de la malnutrition au niveau des formations sanitaires pour comprendre les changements engagés par le FBP-Nutrition. Toutefois, les résultats obtenus à ce niveau ne doivent pas être isolés de toute la chaîne de prévention et prise en charge de la malnutrition. Dans la littérature, il existe une recension des interventions dont l’efficacité a été prouvée pour réduire le retard de croissance, les carences en micronutriments et les décès d'enfants; y compris également des programmes efficaces et à grande échelle qui s'attaquent aux principaux déterminants sous-jacents de la malnutrition (Cfr les séries du Lancet 2003, 2008 et 2013).
Dans notre cas, l'intervention n'a eu aucun impact sur la prévalence de la malnutrition chronique ou aiguë au niveau communautaire. Cela n'est pas surprenant, car on sait d’avance que la malnutrition est multifactorielle et la prévention, le dépistage et la prise en charge de la malnutrition assumés par le système de santé ne peuvent résoudre les problèmes de pauvreté, de sécurité alimentaire, d'eau, d'assainissement et d'hygiène. C’est d’autant plus vrai que le Burundi est fortement dépendant de l'agriculture et que l'insécurité alimentaire y est souvent récurrente. Le FBP-Nutrition n'a pas attaqué ces causes, parce que cela dépasse son champ d'application. En effet, il ne s'agit pas d'un mécanisme capable de traiter des déterminants socio-économiques tels que la richesse, l'éducation des mères et le nombre d'enfants.
Ton évaluation porte sur la période 2014-2017. Trois ans plus tard, as-tu des informations remontant du terrain qui indiquent une persistance des effets positifs précédemment observés et éventuellement une amélioration des autres indicateurs?
J'observe qu'une dynamique politique a été déclenchée par l’intervention FBP-Nutrition et l’étude y relative. La prise en charge de la malnutrition a attiré l’attention des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du FBP au Burundi. Elle est dorénavant intégrée dans le paquet contractualisé à la fois au niveau des CDS (dépistage et prise en charge de la malnutrition aiguë sévère chez les enfants de moins de 5 ans) et des communautés (cas de malnutrition aiguë sévère dépistés, référés et confirmés par le CDS et cas de malnutrition aiguë modérée dépistés, et traités avec succès au niveau communautaire). La question reste posée bien sûr pour la gestion de ces cas de malnutrition modérée au niveau communautaire pour les provinces non appuyées en intrants par le PAM et ne disposant pas par ailleurs des ONG qui interviennent dans l’appui aux foyers d’apprentissage et de réhabilitation nutritionnelle. Il y a aussi une volonté d'action plus large, c'est manifeste notamment du côté de la Banque Mondiale et de son nouveau projet centré sur le 'early child development'.
Plus généralement, le FBP malgré diverses expériences positives dans les pays en développement reste sujet à débat, notamment sur son efficacité, son coût, sa pérennité, les distorsions qu’il introduit dans les systèmes de santé, etc. De par ton expérience sur le sujet, comment te positionnes-tu dans ce débat ?
L'objectif de ma thèse était de comprendre le 'comment' et le 'pourquoi' des résultats produits par l’intervention FBP-Nutrition au niveau des CDS. L’intention n’était pas de prouver que la stratégie est efficace ou pas, mais de mieux comprendre les mécanismes causaux. Avec notre adoption des méthodes mixtes, nous avons pu montrer que l’effet du FBP n’est pas réductible au seul financement supplémentaire accordé aux prestataires de soins; c’est aussi l’influence de la révision des arrangements institutionnels avec des changements au niveau de la gouvernance, des droits de propriété, des droits de décision. Si ces conditions ne sont pas réunies, il est possible de ne pas avoir d’effet escompté compte tenu de la complexité des systèmes de santé, de nombreuses interactions entre les agents ainsi que des interactions entre les diverses interventions qui sont mises en œuvre conduisant à des influences mutuelles. Dans le cas du Burundi, je peux dire que le bilan reste positif.
Un autre élément important - et le Burundi est selon moi un succès à cet égard - est le dispositif mis en œuvre pour la mobilisation des fonds au bénéfice de la stratégie. Les acteurs doivent veiller à la façon dont il embarquent les bailleurs potentiels et surtout les gouvernements qui ont en charge la pérennisation de l’offre des soins à leurs populations. En dépit de la fragilité, cela fait dix ans que le partenariat entre l'État burundais et ses partenaires tient. Mais un tel soutien ne peut naître que du résultat produit par les synergies mises en place par rapport à la complexité des systèmes de santé.
Tes travaux ont fait l’objet de publications dans des revues scientifiques réputées. Tu mérites des félicitations. Quels conseils, quelles astuces pourrais-tu partager avec les jeunes chercheurs, en particulier ceux d’Afrique francophone qui éprouvent souvent des difficultés – notamment celle de la langue – à valoriser leurs travaux sous cette forme ?
Je dirais que la première des choses est d’avoir une détermination à la plus grande visibilité des résultats de ses travaux. C’est cet intérêt personnel qui va susciter motivation et confiance en soi d’abord en songeant à la portée voulue chaque fois que naît l’idée d’un papier à écrire. À l’heure actuelle, il est clair que la plupart des revues scientifiques de grande renommée, et par conséquent fréquemment lues par les chercheurs, sont en anglais. C’est aussi la réalité avec les grandes conférences mobilisant les chercheurs du monde entier. Si l’on n’a pas un intérêt personnel ou particulier de se retrouver aussi dans ce cercle, le travail fait sera moins valorisé et on perdra vite l’intérêt à l’écriture. Étant donné que le gros des références bibliographiques pour diverses thématiques est en anglais, il est possible de bâtir sur cet effort de comprendre ces articles en anglais et ainsi arriver à rédiger en anglais à son tour. Au fur et à mesure, le goût se développe et va croitre vers un texte, certes sujet à améliorations, mais qui est produit quand même. Ainsi, un aspect important sera de se demander quelle est la bonne personne pour faire la relecture du texte produit avant de recourir, pour perfection, à une institution spécialisée. Donc, le plus simple pour ceux qui souhaitent valoriser leurs travaux dans des revues de grande renommée, je pense, c’est d’abord d’oser produire son premier jet dans la langue de la revue visée, ensuite de relire et revisiter le texte produit, le faire relire par quelqu’un d’autre jusqu’à ce qu’il prenne la forme et le style préconisés par la revue. Ainsi, j’encourage vivement les jeunes chercheurs francophones de ne pas se limiter aux seules revues de leur langue mais de briser la glace, viser et découvrir ces revues réputées pour leurs publications.
On en arrive à ma dernière question. Maintenant que tu en as fini avec ta thèse, peux-tu nous dire quelques mots sur ton activité actuelle et tes projets futurs?
La thèse est derrière moi, mais les questionnements sur les thématiques touchées ne sont pas encore épuisés. Depuis le poste que j'occupe à l’Institut National de Santé Publique (INSP) du Burundi, j'aimerais continuer à contribuer à la compréhension des problématiques de la prise en charge de la malnutrition mais également de la mise en œuvre de la stratégie FBP au Burundi.
Actuellement, mon attention va à la constitution d’une unité de recherche dont le focus sera centré sur les thématiques du système de financement de la santé. Mon équipe et moi devons pouvoir produire des travaux qui seront utiles à la communauté scientifique pour faire avancer les connaissances, mais également aux décideurs politiques appelés à œuvrer pour garantir des systèmes de santé performants. à